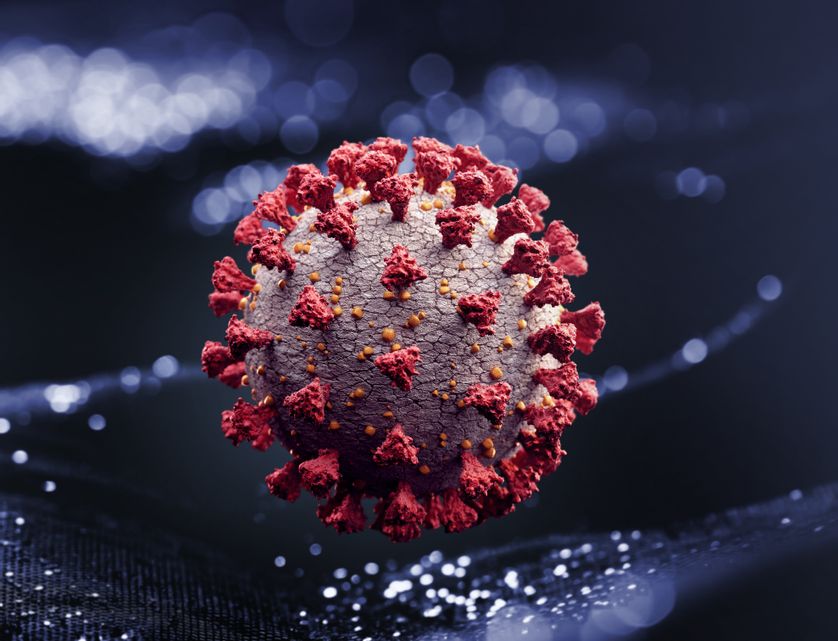En décembre 2020, plus de 72 millions de cas de Covid-19 avaient été diagnostiqués dans le monde. L’incidence réelle était sans doute bien supérieure du fait de l’incapacité à tester et aux formes peu ou asymptomatiques. Dans certaines régions, le taux de séropositivité atteignait 40 %, comme en Amazonie brésilienne. Cela ne doit toutefois pas laisser présager d’une immunité collective suffisante qui ne pourra être obtenue qu’avec une couverture plus importante. Au niveau individuel, un antécédent d’infection et la présence d’une séropositivité ne sont pas une assurance totale contre la réinfection bien que le SARS Cov2 entraîne une réaction immunitaire.
Comme pour les autres coronavirus, la production d’Ac (IgM, puis IgA et IgG) contre le SARS-CoV-2 augmente pendant plusieurs semaines, puis commence à décliner pour se stabiliser ensuite (IgG). Mais la réponse humorale est très variable selon les individus. Des anticorps IgG peuvent être détectés chez la majorité des individus plusieurs mois après l’infection. Mais, chez certains (entre 2,5 % et 28 % selon les études), les anticorps circulants ne sont pas détectables ou de façon très transitoire.
Une équipe états-unienne a réalisé une étude longitudinale prospective, pour évaluer le risque de réinfection sur une cohorte de 3000 jeunes Marines (18-20 ans) nouvellement incorporés. Après une quarantaine de 2 semaines à domicile, ils ont été soumis à une seconde période d’isolement sous contrôle pendant 2 semaines supplémentaires, après avoir réalisé un test sérologique. Ils étaient ensuite suivis pendant 6 semaines, avec un test PCR à la 2e, 4e et 6e semaine, que le test initial se soit révélé positif ou négatif.
Au total 189 d’entre eux étaient séropositifs (soit 6%) au début de la quarantaine suivant l’incorporation. Parmi elles, 19 (10 %) ont eu un test PCR positif au moins une fois au cours des 6 semaines de suivi. En revanche, parmi les 2 247 participants séronégatifs, 48 % ont présenté un test PCR positifs à un moment ou un autre du suivi, soit environ 5 fois plus.
Le taux de protection conféré par une première infection est de 82 %. Ces données sont plus fiables que celles témoignant de la protection vaccinale qui repose sur des critères cliniques et non des tests PCR systématiques.
Si l’on considère l’impact clinique et la replication virale, les infections symptomatiques sont deux fois moins fréquentes chez les participants qui ont déjà été infectés et les charges virales environ 10 fois plus faibles que chez les séronégatifs.
Une étude statistique a en outre prouvée que la réinfection est plus fréquente quand le taux d’anticorps était faible ou quand aucune activité de neutralisation n’était détectable à l’entrée dans l’étude. A contrario un taux élevé d’Ac est très rassurantquant au risque de réinfection.
La possibilité de réinfection chez les patients déjà infectés par le SARS-CoV-2 est d’un intérêt particulier pour la maîtrise de la pandémie et notamment pour l’organisation de la vaccination. Une première infection ne constituant pas une garantie, les patients infectés par le SARS-CoV-2 ne sont pas exemptés de vaccination. En France, la Haute Autorité de Santé recommande l’injection d’une dose de vaccin 3 à 6 mois après l’infection.
Néanmoins même si elle ne permet pas d’empêcher totalement la circulation du virus, une immunité naturelle ou vaccinale suffisante limite la morbi-mortalité liée à la Covid et c’est bien le principal dans l’immédiat. Ce constat rassurant devra être réévalué en fonction de tendances positives (extension de la couverture vaccinale) ou alarmantes (émergence de variants résistants).
Ref : Andrew GL et coll.: SARS-CoV-2 seropositivity and subsequent infection risk in healthy young adults: a prospective cohort study.
Lancet Respir Med., 2021 ; publication avancée en ligne le 15 avril. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00158-2.